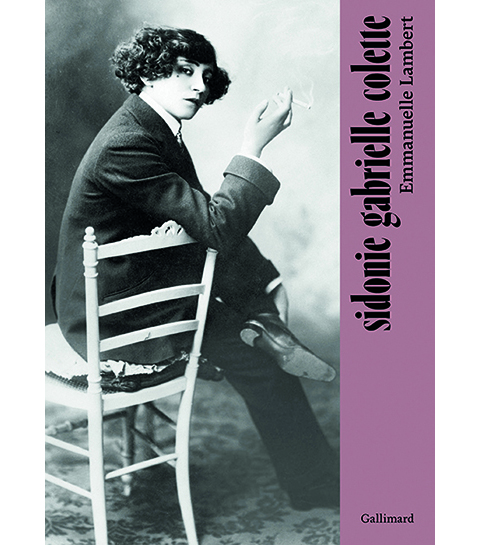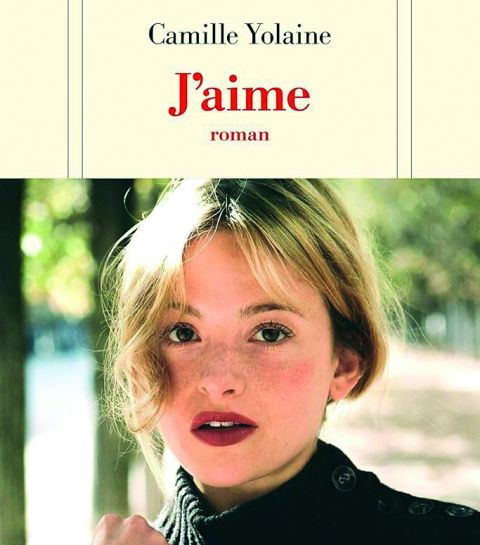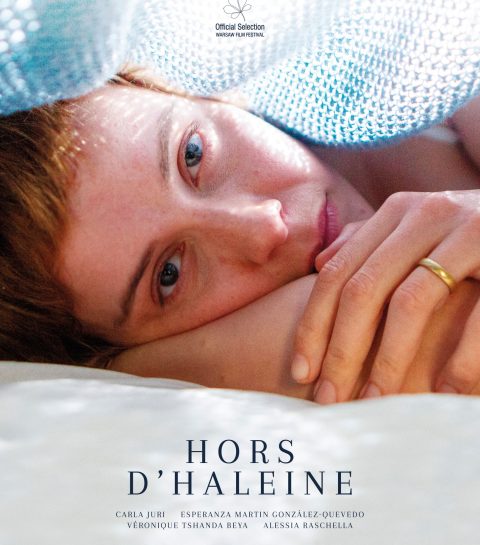Le téléphone sonne dans la nuit. Marco, son fils dont elle n’a pas de nouvelles depuis trois jours, lui demande de venir le chercher à une fête. Tout de suite. Alors qu’ils sont dans la voiture, il lui confesse avoir commis l’irréparable. Commence alors un long voyage au bout de la nuit, au cours duquel mère et fils se rencontrent.
Cette histoire, c’est celle de Jessie, cette femme qui, après avoir écouté le podcast de Mathieu Palain « Des hommes violents » le contacte sur les réseaux sociaux pour lui confier sa vérité. S’en suit un quatrième livre pour l’écrivain-journaliste, Les Hommes manquent de courage, dans lequel il lui prête sa voix. Un roman entre ombre et lumière comme un tunnel, dont on ne sort pas indemne.
Dans l’Avertissement, qui ouvre Les Hommes manquent de courage, vous écrivez : « De nombreuses raisons peuvent conduire un auteur à écrire une histoire en particulier, et pas une autre. Des bonnes, des mauvaises, et un tas de raisons lui échappent. On sait rarement pourquoi on fait les choses au moment où on les fait. Avec de la chance, on comprendra plus tard. » Avez-vous compris ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce nouveau projet de livre ?
Si j’exagère un peu, je dirais que c’est encore un peu tôt pour le comprendre. Mais ça tient beaucoup à la personnalité de Jessie : quand je la rencontre la première fois, je n’ai pas du tout la certitude d’écrire sur elle ; elle m’intéresse et je me lance sans savoir où je vais, ni comprendre pourquoi je le fais. La suite prouvera que l’histoire qu’elle va me raconter pendant une année, cette confiance qu’elle va m’accorder, vient en résonance avec une réflexion que je mène quand même depuis pas mal d’années et qui était déjà présente dans Nos pères, nos frères, nos amis – Dans la tête des hommes violents, à savoir le cycle de la violence et sa transmission. Ces enfants qui se racontent qu’ils seront différents, qu’ils ne reproduiront pas les erreurs de leurs parents et qui pourtant les répètent quand même.
Aujourd’hui, je sais que c’est parce que je la rencontre à ce moment-là – post #MeToo, finalement – que j’y suis réceptif et que j’ai envie de comprendre son histoire et son parcours. Et aussi pourquoi ça lui arrive à elle et à son fils.
Pensez-vous qu’il existe un déterminisme de la violence ?
Non, je pense que la violence est un comportement que l’on intègre dès lors qu’on y a été exposé. Il y a des familles extrêmement pauvres qui vivent dans des quartiers difficiles et dans lesquelles on ne voit pas de transmission de la violence. Inversement, il existe des familles très riches et bourgeoises dans lesquelles l’argent n’a jamais été un problème, mais qui sont traversées par la violence ; on l’a notamment vu dans La Familia Grande de Camille Kouchner. Il n’y a pas de fatalité, non plus : ce sont des décisions qui peuvent être prises afin d’endiguer ce cercle de la violence. Mais pour cela il faut être conscient : ne pas être dans ce phénomène de répétition, ne pas transmettre les manques que l’on a subis à la génération suivante.
La violence est un thème que l’on retrouve en filigrane dans chacun de vos livres. Comment expliquez-vous cette « obsession » ?
Je ne vois pas cela comme une obsession, j’essaye juste de raconter le monde dans lequel je vis Quand j’écris Sale Gosse, la violence m’intéresse parce que j’ai l’impression d’avoir eu la chance de grandir dans une famille aimante, avec mes deux parents à la maison, quand tant de gamins qui n’ont pas connu leur père avancent dans la vie en boîtant et se demandent pourquoi ils pètent les plombs à l’adolescence. Quand je commence à plancher sur ce sujet, je ne me dis pas que c’est une question de violence ; mais une fois qu’on met les mains dans le cambouis et qu’on commence à s’intéresser à ces histoires-là, on se rend très vite compte que la violence est partout. C’est a fortiori vrai dans Ne t’arrête pas de courir, dans lequel il est question de prison, d’enfermement, de privation de liberté et d’un autre cycle infernal – celui de la délinquance – et de comment s’en sortir. C’est également vrai pour les violences conjugales. Et finalement, si je prends votre question à l’envers, je dirais : « qu’est-ce que je pourrais écrire d’autre que des histoires qui ont a trait à la violence ? » Parce qu’en fait les histoires d’amour de gens qui n’ont pas de problème n’ont aucun intérêt pour moi. En tant qu’écrivain et journaliste – en tous cas en tant qu’observateur d’une vie qui bouge et avec la volonté de la raconter – ce serait presque un déni de réalité que de me concentrer sur des histoires dont la violence serait absente. Parce que la vie en tant que telle est quand même assez violente…
Est-ce que cela a été plus compliqué de se faire la voix d’une femme ?
Oui, mais j’ai essayé de réduire la marge d’erreur au minimum. J’ai rencontré Jessie à de nombreuses reprises et, surtout, je l’ai enregistrée à chaque fois, avec son accord évidemment. Pour pouvoir réécouter la bande, prêter attention à sa voix, à la façon dont elle parle, la façon dont elle formule ses phrases, comment elle poursuit sa réflexion lorsqu’elle s’énerve ou qu’elle pleure, comment elle réagit. Tout ceci m’a beaucoup aidé à ne pas être à contre-courant de son propos. Peut-être que certaines lectrices, malgré tout, diront qu’elles ont l’impression de lire un mec qui se prend pour une nana. Ce sont des dizaines et des dizaines d’heures d’enregistrement durant lesquelles elle se raconte et replonge dans son passé. Sans cela, je me serais probablement interdit d’écrire ce récit. Pas pour une question de légitimité – je trouve tout à fait souhaitable que les écrivains tentent de se mettre dans la peau d’autres personnages qu’eux ; sans cela on ne lirait plus que des autofictions ou des autobiographies – mais parce que je pense qu’il ne faut pas sonner faux si on veut embarquer le lecteur dans une histoire. Oui, c’est écrit Mathieu Palain sur la couverture, mais mon objectif est qu’au bout de 30 ou 40 pages vous oubliiez Mathieu Palain : ne reste alors que Jessie et son histoire. Pour cela, il faut du travail, et ça passe par là : un mec qui écrit en essayant de débrancher son cerveau de mec pour se mettre dans la peau d’une femme de 45 ans qui a vécu des choses que lui n’a jamais vécues. La part de risque était quand même vraiment importante ; mais je trouve ça cool de sortir de ma zone de confort et de ne pas céder à la tentation d’écrire une V2, un V3 ou une V4 de mon premier bouquin parce que c’est « chez moi » et que je sais exactement où je vais en l’écrivant.
Avez-vous fait relire le texte à Jessie avant de le publier ?
Non, car ça faisait partie du deal de départ. C’est vraiment un accord de confiance que je passe avec elle, en lui disant : « tu n’auras pas le droit de relire avant, mais je vais tout faire pour ne pas trahir ton histoire ». Si j’ai le moindre doute, je rappelle, je lui demande de me raconter à nouveau ce passage, ce détail… J’ai beaucoup préparé Jessie avant qu’elle ne lise le texte final, en lui expliquant que ça risquait d’être dur. Même si vous retranscrivez exactement l’histoire qu’on vous a confiée, lorsqu’elle est écrite noir sur blanc, digérée par le cerveau d’un autre, il y a une certaine forme de violence. Et ici d’autant plus que l’histoire qu’elle m’a confiée est déjà violente. Ça avait été aussi le cas pour Toumany qui a mis plus de trois mois à lire Ne t’arrête pas de courir : il me disait qu’à chaque fois qu’il ouvrait le livre, les phrases lui sautaient au visage ; ce que je peux totalement comprendre. Quand Jessie a lu Les Hommes manquent de courage, c’est tout le contraire qui s’est produit. Elle m’a affirmé que, pour la première fois, elle se sentait enfin respectée ; elle l’a vraiment pris comme un hommage.
L’histoire de Jessie se raconte au gré d’un voyage en voiture, un motif littéraire assez récurrent. Il s’est imposé de lui-même ?
Oui, parce que ça s’est vraiment passé comme cela. Enfin, pas exactement – ils ne sont pas allés jusque Reims comme dans le livre – mais à 80% en tous cas. Son fils l’a bel et bien appelé au beau milieu de la nuit pour qu’elle vienne les chercher immédiatement, lui et sa copine. Jessie avait prévu de les ramener à la maison, mais, au dernier moment, elle a pris une autre décision : elle a continué à rouler, sans trop savoir où elle allait. Et là, au cours de ce chemin qui ne mène nulle part, la confession est arrivée. Une double confession, puisque les gamins ont craqué et, elle, en réaction à ça, s’est livrée en leur racontant son histoire. « Maintenant, on va se parler d’adultes à adultes et tu vas voir qui je suis, vraiment. »
Je comprends que le voyage soit un procédé littéraire assez naturel, parce que quand vous êtes en voiture, vous ne vous regardez pas dans les yeux ; vous fixez le pare-brise, la route. Ainsi, la confidence est plus simple : vous êtes à la fois dans une sorte de promiscuité, de secret, à l’abri de l’habitacle de la voiture, mais vous n’avez pas à soutenir le regard de votre interlocuteur ni ses expressions.
Ce récit est aussi celui de l’amour absent : les couples sont en échec, tandis que l’amour filial, lui, se heurte à un mur…
L’amour, c’est difficile d’en donner quand on n’en a pas reçu. Ce qui ressort de cette nuit de colère, c’est une introspection des premiers mots et on voit que c’est très « judiciaire » comme manière de réfléchir. C’est-à-dire que, lors d’un procès, on observe qui sont les prévenus, mais également qui sont leurs parents, leurs grands-parents, et, surtout, à quel moment ça a commencé à déconner. Jessie, elle aussi, se pose cette question : « qu’est-ce que j’ai raté, alors que, justement, je ne voulais rien rater ? » Et c’est là où c’est difficile, quand vous avez tellement de blancs, de manques affectifs, de lacunes dans votre histoire personnelle. Les parents de Jessie ont été, au mieux, absents, et dans des styles très différents pour l’un et l’autre, très problématiques : Jessie a été livrée à elle-même, n’a pas été regardée ni aimée. Et je ne suis pas expert en parentalité – j’ai deux filles en bas-âge – mais je ne peux que constater que, et toujours malgré soi, on n’a de cesse que de reproduire ce qu’on a vécu. Des choses aussi anecdotiques qui font dire « j’ai l’impression d’entendre ma mère parler », que des comportements problématiques de violence ou de ne pas savoir comment aimer son enfant, parce qu’on n’a pas reçu cet amour-là lorsqu’on était soi-même enfant. Ce qui est un peu le cas de Jessie. Je pense que c’est là où la transmission, ce qui se passe de génération en génération, est véritablement fascinant.
Il y a aussi cette question de l’instinct maternel qui aurait voulu que Jessie protège son fils, quand elle choisit de le confronter à ses actes…
Je trouve que c’est ce qu’il y a de plus beau dans cette histoire : prendre ses responsabilités, ça ne veut pas dire protéger les siens à tout prix. Protéger un fils, ce n’est pas tenter de le sauver en l’incitant à prendre la fuite, à le défendre envers et contre tout. Quand Jessie réalise que ce que le crime que son fils a commis est le même que celui qui l’a brisée alors qu’elle n’avait que 18 ans, elle ne réfléchit pas : l’inciter à se dénoncer est la seule solution qui s’offre à elle. Est-ce vraiment protéger son fils que de lui éviter la sanction alors qu’il avoue avoir commis ce crime ; ou est-ce que ce ne serait pas justement de l’aider à prendre tout le courage qu’il faut pour affronter la vérité qu’est cette sanction ? Mais c’est quand même quelque chose de très fort, de très beau.
Et puis, ce chapitre, très lumineux – un moment de grâce – dans lequel Jessie et Marco se retrouvent sur une chanson de Whitney Houston…
Les histoires de famille sont sans doute les plus compliquées, parce qu’il y a de l’amour, malgré tout… Des enfants maltraités par leurs parents pleurent à leur enterrement et demeureront inconsolables.
Jessie pousse son fils à se dénoncer, elle est très dure avec lui, parce qu’elle ne peut absolument pas pardonner ce qu’il vient de faire. Pour autant, elle l’aime : il sera toujours son gamin qui rit et qui plisse les yeux face au soleil. Il y aura toujours ces moqueries, ces piques qu’on s’envoie entre mère et fils… Tous ces petits moments, ces petits riens du quotidien, suspendus ; leur rôle ne sera jamais d’atténuer la colère ou l’engueulade qui vient après, mais ils ont le mérite d’exister. Quand je commence un nouveau livre, mon ambition sera toujours de raconter la complexité des relations. Les vrais méchants, qui sont toujours méchants, ça n’existe pas. Enfin, je l’espère…
Mathieu Palain, Les Hommes manquent de courage, aux éditions L’Iconoclaste, sortie le 22 août 2024
À LIRE AUSSI :
Coup de cœur littéraire : le vertige des faux-semblant
Que signifie rêver d’argent ? Décryptage et interprétation
Luxembourg : à quoi ressemble l’intérieur du Palais grand-ducal ?